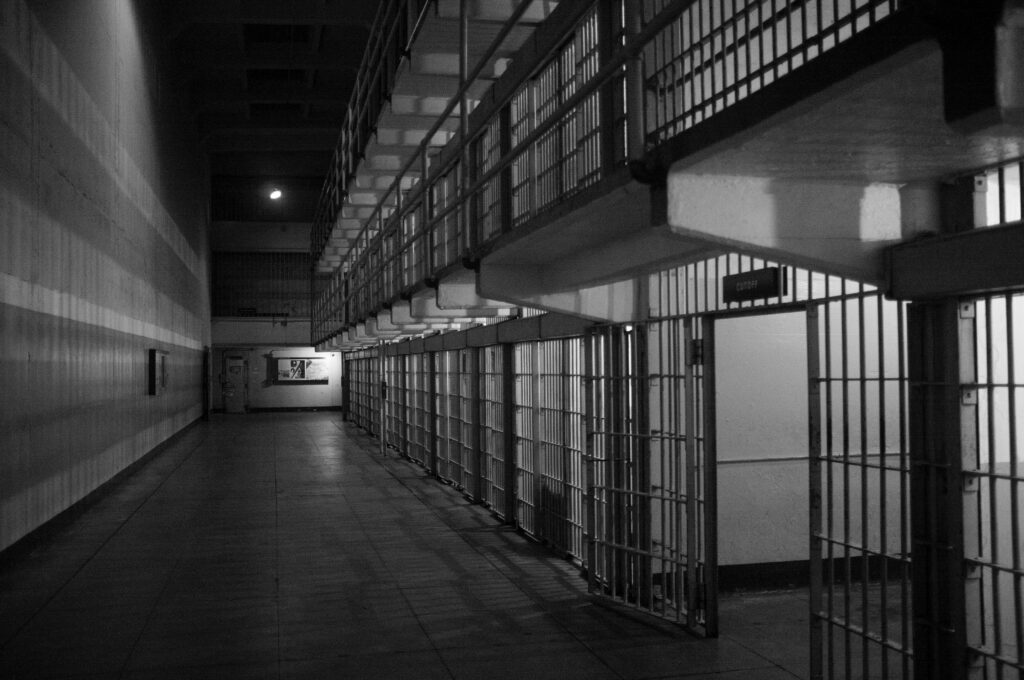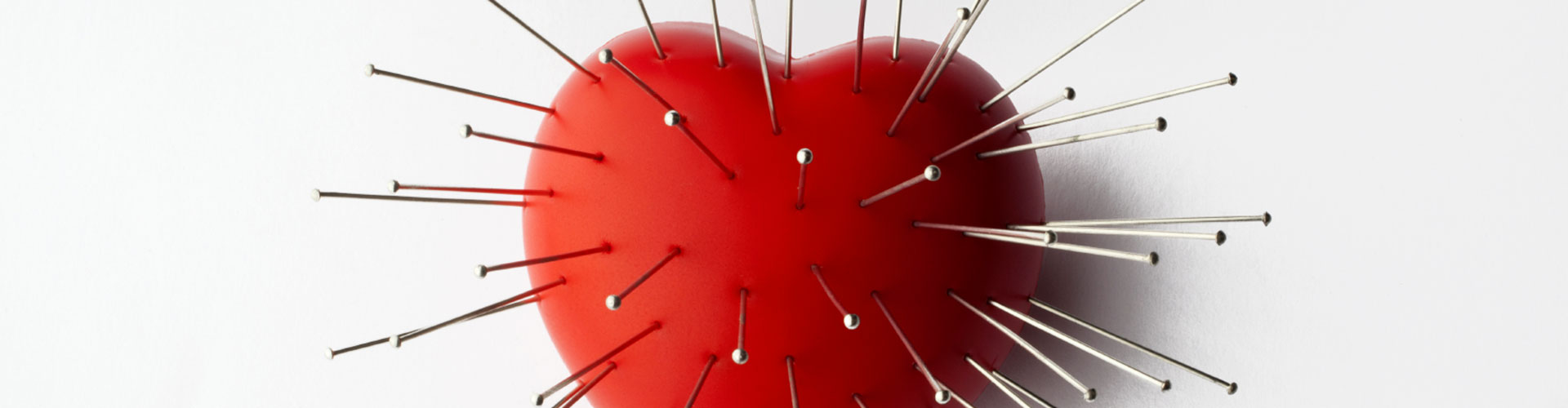La loi française prévoit que toute personne puisse venir dénoncer la commission d’une infraction, par le biais d’une plainte (pour la victime) ou d’une déclaration (personne tierce) au commissariat ou directement auprès d’un Procureur de la République. S’il est établi que le signalement, la dénonciation est manifestement erroné, on encourt ce que l’on appelle une dénonciation calomnieuse.
Dénoncer devient donc très engageant. Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal, s’engage à vous éclairer sur cette infraction.
UNE ACCUSATION A TORT
Qu’est-ce qu’une dénonciation calomnieuse ?
L’article 226-10 du Code pénal exige une véritable «dénonciation» qui peut être faite par tout moyen. Cette dernière doit être dirigée contre une personne déterminée. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit clairement nommée, il suffit qu’elle puisse être identifiée aisément.
Cette dénonciation doit également être spontanée, c’est à dire qu’il ne peut y avoir dénonciation calomnieuse que par la personne qui a pris l’initiative de la dénonciation.
Enfin, cette dénonciation doit porter sur des faits que l’on sait totalement ou partiellement inexact et être adressée à une personne susceptible d’y donner suite, c’est à dire un officier de justice, ou de police administrative, ou judiciaire ; une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ; aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
Le fait dénoncé n’a pas besoin de faire encourir une sanction pénale puisqu’une sanction quelconque est suffisante. En effet, la cour de cassation a estimé que ce délit exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires.
Quelle différence entre une simple dénonciation et une dénonciation calomnieuse ?
A partir du moment où l’auteur sait que le fait dénoncé est inexact ou qu’il n’est pas imputé à la personne dénoncée il y a dénonciation calomnieuse. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé. La simple constatation du fait que la plainte ait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis, ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
Parce qu’il est évident qu’une dénonciation calomnieuse peut, de par la procédure diligentée à votre encontre, vous causer un véritable préjudice professionnel et personnel, il est nécessaire de s’entourer des conseils d’un avocat.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE: QUELLES SANCTIONS ?
Si en pratique, il n’est pas difficile d’accuser quelqu’un à tort d’avoir commis une infraction, cette pratique mensongère peut toutefois vous coûter gros.
Le délit de dénonciation calomnieuse est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires telles que:
- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.